

Entre le ciel et l'enfer, un film japonais de Akira Kurosawa, 1963 |
|||
Distribution:
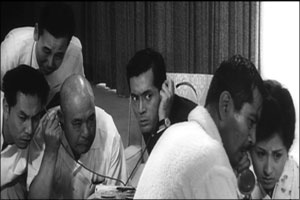 |
|
Fiche technique:
|
|
|
Dans un luxueux appartement qui domine Tokyo, a lieu une réunion entre Kingo Gondo, fondé de pouvoir d'une importante fabrique de chaussures, et les membres du conseil d'administration, qui tentent d'imposer une nouvelle politique de " chaussures bon marché ", à laquelle s'oppose Gondo, hypothéquant ses biens pour pouvoir racheter la majorité des parts. Soudain, on annonce que son jeune fils a été enlevé, ce qui sème la panique, car le kidnapper demande une rançon de 30 millions de yens. Mais un délicat dilemme survient lorsqu'on apprend que le ravisseur s'est trompé et a en fait enlevé le fils du chauffeur de Gondo. Après une longue hésitation, et sous la surveillance secrète de la police, menée par l'inspecteur Tokuro, il décide de payer la rançon, qui doit être jetée par les fenêtres du rapide japonais, le "Shinkansen". Après quoi, l'enquête pour retrouver le kidnappeur commence, avec tous les moyens possibles de la police. Au bout d'une longue investigation, l'inspecteur Tokuro découvre les cadavres de deux complices, et finit par traquer le ravisseur dans les bas fonds de Tokyo, où se retrouvent drogués et pourvoyeurs de drogue. Il arrête le kidnappeur, Takeuchi, un jeune étudiant en médecine, qui, au cours d'une entrevue avec Gondo en prison, dénonce sa richesse insultante... Sous l'apparence d'un film d'action simple et haletant, Kurosawa fait l'éloge du travail bien fait que ce soit celui du chef d'entreprise ou des policiers face aux financiers assoiffés d'argent et de pouvoir avant de montrer la désespérance des bas-fonds de Tokyo pour qui ce discours moral est hélas sans objet. Le film fait se succéder trois parties: La première partie du film, dans la ville haute est une magistrale leçon sur la capacité du cinéma à exprimer un débat d'idées en montrant Gondo, en proie au doute sur la conduite à tenir: sauver l'enfant de son chauffeur ou assurer l'aisance de sa famille et sauver son métier de chef d'entreprise qui lui tient à cœur. Les trente millions de yens, rançon extravagante demandée par le ravisseur, correspondent à peu près aux 50 millions qu'il a rassemblé en vendant et hypothéquant tous ses biens pour prendre le contrôle de sa société. L'un des inspecteurs relaie d'ailleurs l'interrogation du spectateur sur le lien possible entre les deux intrigues : financière et policière. Une fois la rançon remise, la deuxième partie est centrée sur l'enquête policière et le travail des nombreux inspecteurs à la recherche de tous les indices possibles pour retrouver la fortune de Gondo que le sacrifice de sa fortune a rendu extrêmement populaire à Tokyo. Kurosawa met alors quasiment hors champ Gondo pour dénoncer, via les policiers, les pratiques odieuses des financiers ou des cadres assoiffés de pouvoir qui haïssent le travail bien fait de Gondo contrairement aux ouvriers qui ne l'aiment pas mais respectent sa compétence et sa droiture. La quête du chauffeur et de son fils pour retrouver le lieu du kidnapping rend compte de cet humanisme qui croit encore possible le rachat et la réconciliation. Cette partie rappelle parfois Un chien enragé : même sens de l'humour, même intensité dramatique, même sens de l'atmosphère, même rapidité dans le développement du drame. La troisième partie dans les bas-fonds de Tokyo est beaucoup plus noire et marque de façon beaucoup plus désespérée l'impossible réconciliation entre les riches et les pauvres. Genji explose de colère, de haine et d'impuissance face à Gondo qu'il a fait appeler. Au dernier plan, le rideau se ferme entre eux. L'adaptation d'un roman américain accrédite artificiellement auprès d'une partie du public l'idée que Kurosawa est le moins japonais, ou le plus occidentalisé, des cinéastes nippons. Dans une topographie qui oppose à nouveau les mondes du haut et du bas, les riches et les pauvres, tout schématisme disparaît quand intervient la rencontre entre l'homme et son « double ». Akira Kurosawa déclare: |
|||